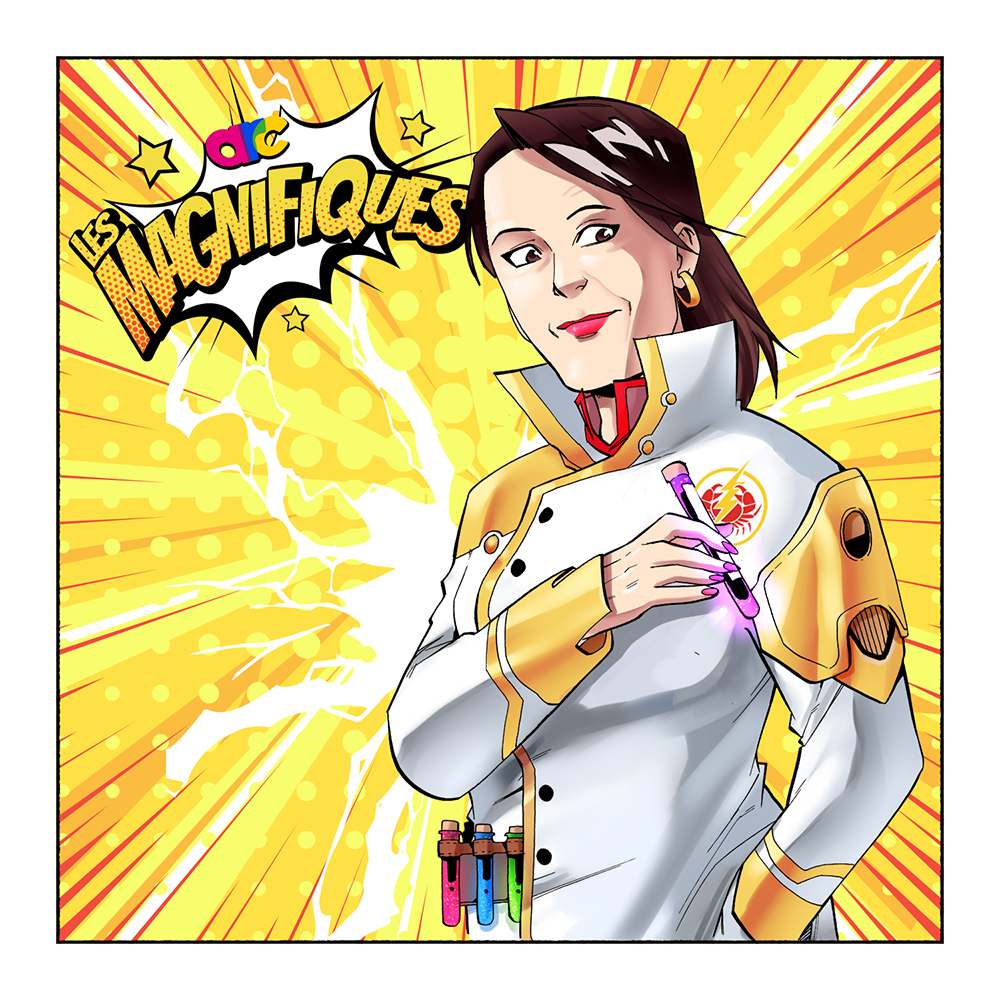Les entretiens "Magnifiques" - Martine Piccart : en 4 ans, des progrès marquants face aux cancers du sein
 En avril 2018, nous remettions le 46ème Prix Léopold Griffuel de recherche translationnelle et clinique à Martine Piccart, professeure d’oncologie à l’Université libre de Bruxelles et cheffe du département de médecine à l’Institut Jules Bordet. Le Jury saluait ainsi le travail inlassable mené par Martine Piccart depuis une trentaine d’années, pour mobiliser les acteurs de la recherche clinique et faire progresser la prise en charge des patientes par tous les moyens possibles, thérapies ciblées, chimiothérapies, hormonothérapies, désescalade thérapeutique…
En avril 2018, nous remettions le 46ème Prix Léopold Griffuel de recherche translationnelle et clinique à Martine Piccart, professeure d’oncologie à l’Université libre de Bruxelles et cheffe du département de médecine à l’Institut Jules Bordet. Le Jury saluait ainsi le travail inlassable mené par Martine Piccart depuis une trentaine d’années, pour mobiliser les acteurs de la recherche clinique et faire progresser la prise en charge des patientes par tous les moyens possibles, thérapies ciblées, chimiothérapies, hormonothérapies, désescalade thérapeutique…Quatre ans plus tard, nous avons retrouvé Martine Piccart en visite à l’exposition Les Magnifiques, dont elle est une des personnalités scientifiques que le public est invité à découvrir. Nous lui avons proposé de revenir sur les avancées qui ont marqué la prise en charge des patientes ces quatre dernières années, ou qui pourraient le faire dans les temps à venir. L’occasion de prendre la mesure du rythme auquel progresse la recherche clinique, pas à pas mais de façon significative.
Avant même de répondre à notre première question, les premiers mots de Martine Piccart ont été pour les donateurs et testateurs. Et plus généralement sur l’importance d’organisations caritatives comme la Fondation ARC, sans lesquelles certains essais cliniques – délaissés par l’industrie pharmaceutiques – ne pourraient être réalisés.
Propos recueillis par Raphaël Demonchy pour la Fondation ARC
Entretien
Raphaël Demonchy : De nombreux chantiers étaient en cours lorsque vous avez reçu le Prix Fondation ARC Léopold Griffuel, en 2018. Comment ont-ils évolué ?
Martine Piccart : Même si le temps qui s’est écoulé est court dans l’agenda de la recherche il y a eu, malgré tout, des résultats marquants.
En premier lieu je citerais l’étude MINDACT, qui concerne les femmes touchées par un cancer du sein hormonodépendant avec une atteinte modérée des ganglions. Cette situation clinique préoccupante implique généralement l’administration d’une chimiothérapie après l’opération, pour limiter le risque de récidive ou de métastase. Cet essai clinique de grande ampleur, que le BIG* a largement contribué à conduire, avait comme principal but de savoir si, lorsqu'on identifie dans la tumeur une signature génétique favorable, on peut se contenter de ne donner que l'hormonothérapie et éviter la chimiothérapie.
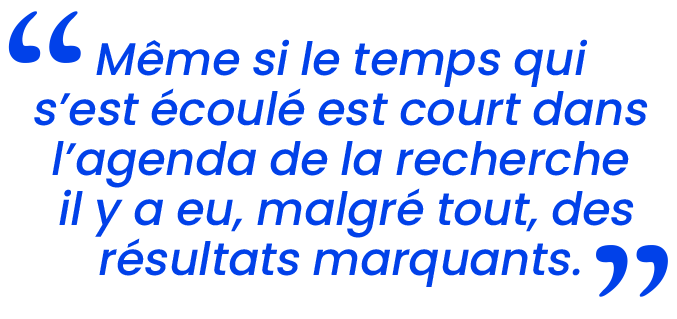
En 2016, avec 5 ans de recul, on avait déjà pu montrer que le taux de récidive était faible chez ces femmes traitées uniquement par hormonothérapies et que la chimiothérapie ne semblait pas apporter de bénéfice. Mais, dans ces cancers hormonodépendants, on sait malheureusement qu'il y a encore un risque non négligeable de rechute entre 5 et 10 ans après la chirurgie.
Finalement, en 2020, après un suivi de plus de 9 ans, on a eu une réponse claire : cette signature tient bien la route, mais chez les femmes ménopausées seulement ! Même quand quelques ganglions sont touchés, si la signature génomique indique un bas risque, il y a une évolution tout à fait satisfaisante avec l'hormonothérapie seule. Chez les femmes plus jeunes, pré-ménopausées, le maintien d’une chimiothérapie préalable à l’hormonothérapie semble apporter un bénéfice, même quand la signature génomique indique un faible risque de récidive. On n’explique pas encore très bien ce résultat, qui nous a surpris, mais il semble qu’il soit robuste ; une autre étude, comparable, menée aux USA, va dans le même sens.
Malgré cette déception “relative”, l’essai clinique a permis une vraie modification des pratiques. Aujourd’hui on sait que les oncologues se sont saisi de ces résultats et utilisent la signature génétique pour ajuster la prise en charge de leurs patientes ménopausées. Et même si la recherche de signature a un coût pour la collectivité, il a été montré en Belgique qu’il était bien moins élevé que celui des chimiothérapies qu'elle permettait d'éviter. Pour les femmes jeunes, la question reste cependant ouverte. On pense que si on renforçait l'hormonothérapie, on pourrait avoir la même puissance protectrice qu'avec la chimiothérapie. Sur ce point, on attend les résultats d'une étude en Angleterre, dans laquelle les investigateurs prescrivent une hormonothérapie renforcée chez les femmes jeunes qui ne recevaient pas de chimiothérapie.
Le second résultat auquel je pense porte sur une étude qui me tenait particulièrement à cœur, typique de ce que la recherche clinique académique peut produire. En décembre dernier, au symposium international de San Antonio, le BIG a révélé les résultats de l’étude POSITIVE, qui devait nous permettre de savoir s’il est possible d’interrompre une hormonothérapie qui dure normalement 5 à 10 ans pour que des patientes jeunes puissent envisager une grossesse. Nous avons recruté 500 femmes, qui ont interrompu ce traitement pendant deux ans – après l’avoir suivi pendant au moins 30 mois – lorsqu’elles avaient un projet de grossesse. Après 41 mois de suivi, nous pouvons dire que les résultats sont très positifs avec 365 naissances et, bien-sûr, pas de hausse significative du risque observé de récidive.
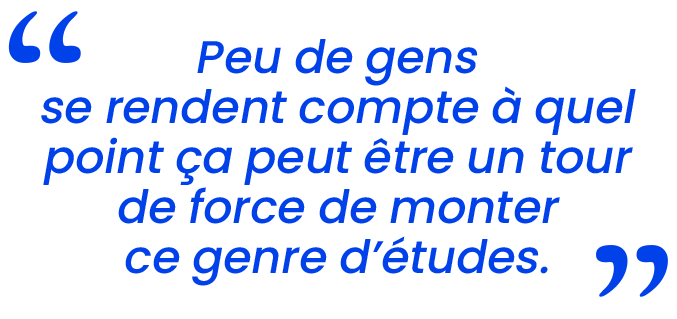
Enfin il me semble qu’une troisième avancée a été marquante : la progression des thérapies ciblées destinées aux patientes porteuses des fameuses mutations héréditaires des gènes BRCA. Chez ces femmes, des molécules qui bloquent l’action des protéines appelées PARP, impliquées dans la réparation de l’ADN étaient déjà utilisées dans un contexte palliatif, en cas de rechutes ou de maladie métastatique. Dans l’essai que nous avons mis en place, avec nos collègues américains, tout l’enjeu était de savoir s’il était intéressant d’utiliser ces anti-PARP de façon plus précoce, pour prévenir les récidives ou l’évolution métastatique. Avec un suivi de 4 ans, les résultats publiés en 2022 montrent que l’administration d’olaparib pendant un an après la chimiothérapie permet d’allonger la survie globale des patientes qui ont un cancer diagnostiqué précocement mais dont le risque métastatique est élevé. Ce résultat très positif a vraiment eu une saveur particulière tant il a été le fruit d’un très gros travail collaboratif. Peu de gens se rendent compte à quel point ça peut être un tour de force de monter ce genre d’études : les patientes porteuses de mutations BRCA ne sont pas nombreuses (10% des cancers du sein) et, parmi elles, il fallait encore sélectionner celles dont les tumeurs étaient à haut risque d’évolution, les autres ayant déjà toutes les chances de guérir grâce aux traitements standards. C’est pour coordonner ce type d’études, qui impliquent des centaines de centres à travers le monde, qu’une structure comme le BIG se révèle indispensable.
RD : Au-delà de ces résultats obtenus grâce au BIG, quels sont, selon vous, les progrès significatifs de ces dernières années dans la prise en charge des cancers du sein ?
MP : En quatre ans la prise en charge des patientes n’a pas radicalement changé, mais deux avancées m’ont semblé impressionnantes.
La première concerne les cancers du sein triple-négatifs, dont l’évolution est dramatique lorsqu’ils ne sont pas sensibles à la chimiothérapie. Face à ces situations, un essai mené par l’industrie a radicalement changé la donne, en testant l’ajout d’une immunothérapie à la chimiothérapie, pendant un an. Les chances de guérison ont augmenté pour ces femmes touchées par un cancer triple négatif et c’est une avancée qu’on attendait depuis longtemps ! Suite à ces résultats, l’immunothérapie est en train de rentrer dans la pratique et bénéficie à de nombreuses patientes, dès les stades précoces de la maladie.
Pour autant, beaucoup de questions restent en suspens : par exemple la durée assez longue de cette immunothérapie : pourquoi un an ? Effectivement, on peut penser qu’une fois le système immunitaire lancé, on pourrait mettre fin au traitement au bout de 3 à 4 mois sans perte d’efficacité. Les questions de ce type doivent être résolues, la recherche publique s’en saisit, mais le progrès porté par les immunothérapie est déjà sensible.
En toute honnêteté, l’autre avancée à laquelle je pense a été une surprise. Elle concerne les patientes qui ont un cancer hormonodépendant à haut risque, c’est-à-dire les tumeurs de grande taille ou avec de nombreux ganglions touchés, qui expriment des récepteurs hormonaux et pas de récepteur HER2 (voir ci-contre). On sait que ces cancers ne sont pas toujours sensibles aux chimiothérapies et on compte donc beaucoup sur l’hormonothérapie pour contrôler la maladie à long terme. Dans l’étude à laquelle je fais référence, un inhibiteur des protéines CDK4/6 qui s’appelle l’abemaciclib est pris, pendant deux ans, en complément d’une hormonothérapie qui dure, elle, dix ans.
Nous avions déjà vu des résultats intermédiaires de cet essai mais ils n’avaient pas convaincu les oncologues. Les différences entre les femmes qui avaient reçu la chimiothérapie puis l’hormonothérapie et celles qui avaient reçu la chimiothérapie puis l’hormonothérapie et l’abemaciclib n’étaient pas de grande ampleur et on s’attendaient à ce qu’elles s’atténuent avec le temps. Or c’est l’inverse qui s’est produit : les résultats ont été communiqués à San Antonio en décembre et, avec un recul de quatre ans, on voit que l’écart s’est creusé entre les deux groupes et le risque de récidive diminue de 35% avec l’abemaciclib. Ces résultats devraient changer les standards de prise en charge pour de nombreuses patientes.
Cette dernière étude est aussi intéressante parce qu’elle illustre très bien la finesse de la recherche clinique et les précautions qu’il faut prendre pour la faire avancer : les premiers résultats de l’abemaciclib, chez des patientes métastatiques, avaient été très bons. Il était donc crédible de s’attendre à quelque chose de positif dans une phase plus précoce de la maladie. Sauf qu’une autre étude proposée à ce même stade précoce et testant un autre inhibiteur de CDK4/6 (le palbociclib) avait beaucoup déçu il y a environ deux ans ! Qu’est-ce qui explique, alors, les résultats publiés dernièrement avec l’abemaciclib ? Même si la cible est la même, les deux inhibiteurs sont différents, la posologie change aussi… les hypothèses sont diverses mais le résultat est là, et c’est un énorme progrès.
RD : Quand vous regardez votre champ de recherche, qu’est-ce que vous aimeriez voir avancer en particulier ?
MP : Aujourd’hui, on dépense beaucoup, dans le cadre de presque tous les essais cliniques, pour collecter divers échantillons (biopsies, sang…) dans le but d’identifier de nombreux biomarqueurs potentiels. Or je ressens une grande frustration de constater que cette recherche translationnelle ne progresse que trop peu au regard des investissements.
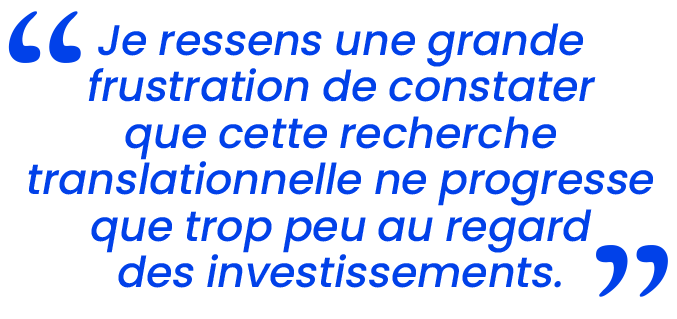
En fait, nous sommes encore dans un modèle qui cherche à obtenir des résultats en menant des analyses auprès de quelques centaines de patients. En ce qui me concerne, je suis de plus en plus convaincue qu’il faut réussir à collaborer beaucoup plus pour partager des données à plus grande échelle. C’est de cette façon qu’on réussira à identifier et valider des biomarqueurs solides.
RD : Qu’est-ce qui vous semble porteur d’espoir aujourd’hui ?
MP : Je peux citer une nouvelle classe de molécules thérapeutiques qui a émergé il y a plusieurs années et qui se développe très rapidement : les anticorps conjugués (ADC pour antibody drug conjugate). Ces médicaments fonctionnent comme un cheval de Troie : l’anticorps porte une charge de chimiothérapie qu’il délivre de façon spécifique à la cellule cancéreuse, grâce à sa capacité à reconnaitre une cible bien précise sur cette dernière.
L’un des premiers ADC a été le trastuzumab emtansine, développé pour combattre les cancers du sein HER2 positifs (NDLR : les cellules cancéreuses expriment le récepteur HER2, capable de stimuler leur croissance). Ce médicament associe le trastuzumab, un anticorps dirigé contre le récepteur HER2 et un agent cytotoxique qui bloque des mécanismes impliqués dans la division des cellules. Mais un nouvel ADC, Le trastuzumab deruxtecan, est en train de supplanter cette première génération.
La nouvelle génération a gagné en sensibilité et ouvre de nouvelles perspectives cliniques : le trastuzumab emtansine était réservé aux patientes porteuses de tumeurs dites « HER2 positives », mais on s’est rendu compte que la sensibilité du trastuzumab deruxtecan était telle qu’il parvenait à avoir un effet même lorsque la protéine HER2 n’était que très peu exprimée dans la tumeur. Ce constat a amené les oncologues à considérer une nouvelle catégorie de tumeurs, les « HER2-low » (HER2 bas), susceptibles de bénéficier de ces traitements. Cette « classification » n’existait pas du tout en 2018 et elle concerne les cancers hormonodépendants comme les triple négatifs ! Elle implique que l’on progresse encore dans notre façon de caractériser ce biomarqueur HER2 : les laboratoires d’anatomopathologie doivent mettre au point des méthodes pour gagner en précision et s’assurer de la bonne reproductibilité des résultats entre les centres de soin.
Evidemment, les perspectives qu’ouvrent les ADC dépassent largement le ciblage de HER2, puisque de nombreux développements se basent sur d’autres marqueurs spécifiques des cancers avec, par exemple, l’émergence d’anti-TROP2, une molécule très présente dans les cancers triple négatifs. Aujourd’hui la technologie de conception et de production des ADC est très efficace et plus d’une centaine est en développement ! Je pense que nous pouvons attendre beaucoup de ces molécules à l’avenir.

Pour en savoir plus sur les avancées de la recherche sur le cancer.