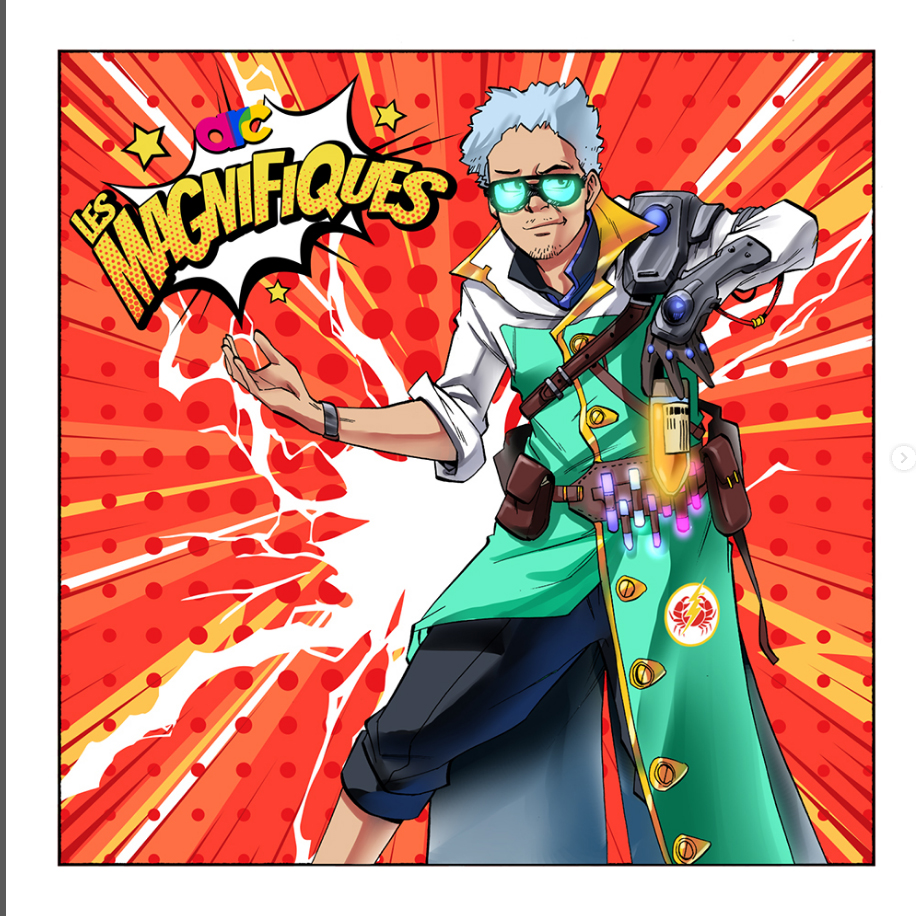Les entretiens "Magnifiques" - Sebastian Amigorena : la révolution des immunothérapies, de Rabbi Jacob à Karl Popper
 Sebastian Amigorena est un chercheur qui a contribué – et contribue encore ! – à construire ce que la communauté des chercheurs et médecins en cancérologie a coutume d’appeler « la révolution des immunothérapies ». De fait, la rétrospective de ces 17 ans qui le séparent de son Prix Fondation ARC Leopold Griffuel pourrait facilement donner le vertige. Pourtant, quand on évoque cette révolution, c’est une scène de Rabbi Jacob qui lui vient à l’esprit. L’humour pour désacraliser, efficace. Auto-dérision ? Un peu, mais surtout beaucoup de recul sur les grandes avancées de son champ scientifique. Pas de fausse modestie pour autant, Sebastian Amigorena sait ce qu’il apporte à cette science qui, véritablement, est en train de modifier en profondeur la façon dont on soigne de plus en plus de patients. De Rabbi Jacob à Karl Popper*, un entretien avec Sebastian Amigorena, immunologiste et directeur de l’unité INSERM « Immunité et cancer ».
Sebastian Amigorena est un chercheur qui a contribué – et contribue encore ! – à construire ce que la communauté des chercheurs et médecins en cancérologie a coutume d’appeler « la révolution des immunothérapies ». De fait, la rétrospective de ces 17 ans qui le séparent de son Prix Fondation ARC Leopold Griffuel pourrait facilement donner le vertige. Pourtant, quand on évoque cette révolution, c’est une scène de Rabbi Jacob qui lui vient à l’esprit. L’humour pour désacraliser, efficace. Auto-dérision ? Un peu, mais surtout beaucoup de recul sur les grandes avancées de son champ scientifique. Pas de fausse modestie pour autant, Sebastian Amigorena sait ce qu’il apporte à cette science qui, véritablement, est en train de modifier en profondeur la façon dont on soigne de plus en plus de patients. De Rabbi Jacob à Karl Popper*, un entretien avec Sebastian Amigorena, immunologiste et directeur de l’unité INSERM « Immunité et cancer ». Propos recueillis par Laurence Michelena et Raphaël Demonchy pour la Fondation ARC
Entretien
Raphaël Demonchy : On parle de « révolution » au sujet de l’immunothérapie. Peut-on réellement voir un « changement de régime » grâce à ces thérapies ou sont-elles seulement l’aboutissement de travaux qui, dans tous les domaines de la cancérologie, poussent vers des solutions plus adaptées à la biologie des tumeurs ?
Sebastian Amigorena : Votre question me fait penser à une citation qui va peut-être vous surprendre, je crois que c’est de Mao. Je précise que je n’ai pas lu Mao dans le détail, je la connais parce que j’ai vu le film de Louis de Funès, Rabbi Jacob ! « La révolution, c’est comme une bicyclette, quand elle n’avance plus, elle tombe ! » (après visionnage par nos équipes de fact-checkers, la citation est en fait attribuée à Che Guevara dans le film, mais l’idée est la même !!! NDLR). 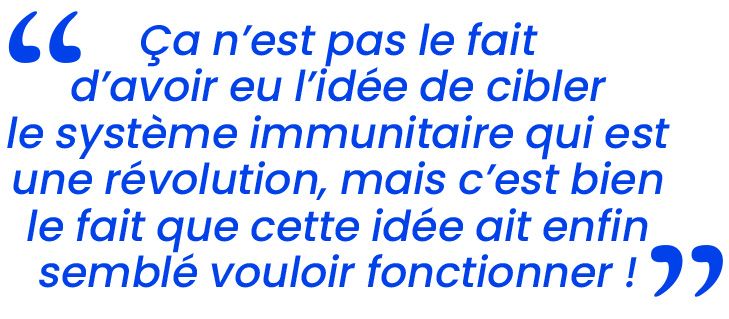 Je trouve que l’image est assez belle et qu’elle s’applique à beaucoup de révolutions - y compris politiques - et aussi aux immunothérapies. Une révolution se prépare et il faut l’entretenir une fois qu’elle a pris forme ! L’immunothérapie, a acquis son statut de véritable « thérapie du cancer » au milieu des années 2010, quand des essais cliniques ont commencé à montrer qu’on réussissait à guérir des patients atteints de mélanomes au stade métastatique, puis de cancers du poumon en agissant sur le système immunitaire, et non sur les cellules cancéreuses (comme le font la chimiothérapie ou la radiothérapie). L’idée d’agir sur le système immunitaire n’était pas nouvelle en soit, on avait essayé pas mal d’approches par le passé, mais jusqu’alors, les réussites n’avaient été qu’anecdotiques. Or, depuis les années 2010, le nombre de cancers qui se sont avérés sensibles aux inhibiteurs de points de contrôle immunitaire a grandi et on a pu sauver des centaines de milliers de patients grâce à ces médicaments. Donc ça n’est pas le fait d’avoir eu l’idée de cibler le système immunitaire qui est une révolution, mais c’est bien le fait que cette approche thérapeutique ait enfin fonctionné ! Et effectivement, avec ces réussites (qui sont encore partielles), on peut envisager de tous nouveaux angles d’attaque pour traiter les patients atteints de cancer.
Je trouve que l’image est assez belle et qu’elle s’applique à beaucoup de révolutions - y compris politiques - et aussi aux immunothérapies. Une révolution se prépare et il faut l’entretenir une fois qu’elle a pris forme ! L’immunothérapie, a acquis son statut de véritable « thérapie du cancer » au milieu des années 2010, quand des essais cliniques ont commencé à montrer qu’on réussissait à guérir des patients atteints de mélanomes au stade métastatique, puis de cancers du poumon en agissant sur le système immunitaire, et non sur les cellules cancéreuses (comme le font la chimiothérapie ou la radiothérapie). L’idée d’agir sur le système immunitaire n’était pas nouvelle en soit, on avait essayé pas mal d’approches par le passé, mais jusqu’alors, les réussites n’avaient été qu’anecdotiques. Or, depuis les années 2010, le nombre de cancers qui se sont avérés sensibles aux inhibiteurs de points de contrôle immunitaire a grandi et on a pu sauver des centaines de milliers de patients grâce à ces médicaments. Donc ça n’est pas le fait d’avoir eu l’idée de cibler le système immunitaire qui est une révolution, mais c’est bien le fait que cette approche thérapeutique ait enfin fonctionné ! Et effectivement, avec ces réussites (qui sont encore partielles), on peut envisager de tous nouveaux angles d’attaque pour traiter les patients atteints de cancer.
RD : Certaines des questions scientifiques que vous posiez à l’époque du Prix s’inscrivent-elles dans cette révolution thérapeutique ?
SA : En 2006 je ne travaillais pas à proprement parler sur l’immunothérapie. Je travaillais sur des sujets qui ont servi ou servent à l’immunothérapie mais qui étaient très fondamentaux. Je m’intéressais aux mécanismes de présentation des antigènes par les cellules dendritiques, c’est-à-dire les mécanismes qui permettent l’initiation de la réponse immunitaire dirigée contre tel ou tel antigène. A l’époque, le grand espoir d’application était d’utiliser les cellules dendritiques pour immuniser les patients et induire des réponses immunitaires anti tumorales. Pour avancer il fallait jouer sur deux tableaux en même temps : le choix des antigènes (comment sélectionner ceux qui seront efficaces, comment les préparer, comment les « présenter » aux cellules dendritiques ?) ainsi que celui des vecteurs, c’est-à-dire la façon dont on sélectionne et prépare les cellules dendritiques. Tous les efforts faits à l’époque n’ont pas donné les résultats attendus. Est-ce parce que l’idée n’était pas bonne ou parce que l’implémentation, la mise en pratique de l’idée n’a pas été bien faite, sincèrement, c’est difficile à dire. Dans les années 2015-2017, cet élan de la vaccination est un peu tombé dans l’oubli, mais le sujet est en train de renaître, notamment parce qu’on a commencé à s’intéresser à des mutations qu’on appelle « passagères ». En fait l’idée est assez simple : dans un tissu, des mutations différentes surviennent dans des cellules et sont en général relativement silencieuses. Mais quand l’une des cellules devient cancéreuse, sous l’effet de mutations « oncogéniques », elle se multiplie activement, forme une tumeur et les mutations passagères que portait la cellule originelle, se retrouvent représentées de façon beaucoup plus massive dans le tissu. Les protéines qui sont produites à partir de ces gènes mutés deviennent alors visibles par le système immunitaire et sont susceptibles de déclencher une réponse spécifiquement dirigée contre elles, au dépend de la tumeur. Depuis quelques années, et encore plus depuis le COVID, les laboratoires et les entreprises développent des approches, grâce à l’ARN, pour produire des vaccins totalement personnalisés, sur la base de l’identification des mutations passagères des cellules tumorales. Les résultats préliminaires communiqués sont très encourageants. Il semblerait que la vaccination par ARNm permette bien de déclencher une réponse immunitaire, et que l’ajout d’un anti-PD1 (une immunothérapie par inhibition d’un point de contrôle immunitaire, NDLR) soit nécessaire pour que cette réaction immunitaire se traduise en une réponse clinique.
RD : Même si vos travaux étaient très fondamentaux en 2007, vous avez créé un laboratoire tourné vers la clinique, avec le Centre d’immunothérapie de l’Institut Curie. Cette nouvelle phase a-t-elle modifié votre façon d’envisager vos projets ?
SA : En 2017, nous avons unifié plusieurs équipes qui étaient disséminées dans l’hôpital et dans un bâtiment de recherche, pour créer un gros labo d’une centaine de chercheurs et de médecins. Je suis assez fier d’avoir contribué à créer le département et le Centre d’immunothérapie parce que nous avons réussi, je crois, à faire naître une dynamique intéressante entre nos préoccupations très fondamentales et l’explosion des immunothérapies. Petit à petit nous avons donné une dimension translationnelle à certains de nos projets fondamentaux et, réciproquement, on s’est dit qu’on pouvait faire entrer dans des projets translationnels certains sujets que l’on creusait depuis pas mal de temps. Globalement, cette organisation nous permet de travailler sur des questions importantes comme le mode d’action des immunothérapies, les résistances aux traitements ou l’identification de nouvelles cibles… D’une façon générale, il faut admettre qu’on ne sait vraiment pas grand-chose sur le fonctionnement des immunothérapies. En fait, la seule connaissance indiscutable dont on dispose, c’est qu’elles font gagner des années de survie aux patients. Et c’est bien ça qui compte, finalement !
Laurence Michelena : Tout ce que vous savez, c’est que vous ne savez rien, c’est ça ?
SA : Après Rabbi Jacob on va citer Karl Popper* et rejouer la bagarre entre positivistes et négationnistes ! Mais oui, c’est tout à fait ça. On nage dans un océan d’ignorance dans lequel on réussit à construire quelques bribes de connaissance, des bouées qui nous permettent de ne pas avancer au hasard et, parfois, de faire émerger des choses intéressantes pour la clinique. Evidemment, et c’est pour ça qu’on en revient à Karl Popper, chaque bouée peut disparaître d’un instant à l’autre si des résultats plus robustes viennent à la contredire. 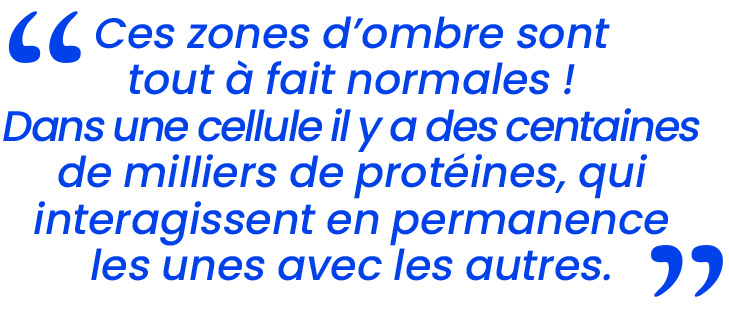 Si je reviens aux anti-PD1, on sait quelle est leur action sur des lymphocytes T in vitro, mais on ne sait pas bien comment ils agissent in vivo. Certains résultats indiquent qu’ils pourraient intervenir au tout début de la réponse, en activant des cellules dendritiques, plutôt qu’en levant le blocage des lymphocytes T comme on pourrait l’imaginer a priori. Ces zones d’ombre sont tout à fait normales ! Dans une cellule il y a des centaines de milliers de protéines, qui interagissent en permanence les unes avec les autres. Si on considère ces millions d’interactions à l’échelle de l’organisme, on comprend vite que la biologie est bien trop complexe pour que l’on soit capable de dire de façon catégorique et exhaustive sur quelles cibles, dans quel timing et dans quelle proportion agit telle ou telle thérapie.
Si je reviens aux anti-PD1, on sait quelle est leur action sur des lymphocytes T in vitro, mais on ne sait pas bien comment ils agissent in vivo. Certains résultats indiquent qu’ils pourraient intervenir au tout début de la réponse, en activant des cellules dendritiques, plutôt qu’en levant le blocage des lymphocytes T comme on pourrait l’imaginer a priori. Ces zones d’ombre sont tout à fait normales ! Dans une cellule il y a des centaines de milliers de protéines, qui interagissent en permanence les unes avec les autres. Si on considère ces millions d’interactions à l’échelle de l’organisme, on comprend vite que la biologie est bien trop complexe pour que l’on soit capable de dire de façon catégorique et exhaustive sur quelles cibles, dans quel timing et dans quelle proportion agit telle ou telle thérapie.
LM : Mais comment réussissez-vous à garder la foi face à toute cette incompréhension ?
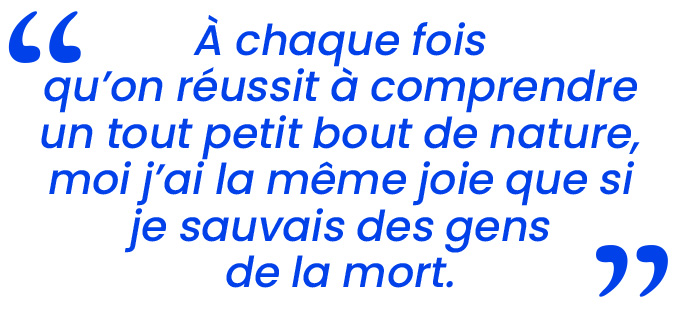 SA : En fait, à chaque fois qu’on réussit à comprendre un tout petit bout de nature, moi j’ai la même joie que si je sauvais des gens de la mort. Chacun participe à cette aventure de façon différente, selon sa foi, sa sensibilité. Je pense que la recherche biomédicale est faite de tout cet éventail, de la recherche très fondamentale jusqu’à la prise en charge des patients, et j’imagine que la joie d’avancer est la même pour chacune des personnes qui s’implique dans cette aventure collective.
SA : En fait, à chaque fois qu’on réussit à comprendre un tout petit bout de nature, moi j’ai la même joie que si je sauvais des gens de la mort. Chacun participe à cette aventure de façon différente, selon sa foi, sa sensibilité. Je pense que la recherche biomédicale est faite de tout cet éventail, de la recherche très fondamentale jusqu’à la prise en charge des patients, et j’imagine que la joie d’avancer est la même pour chacune des personnes qui s’implique dans cette aventure collective.
*Karl Popper : Philosophe des sciences né en 1902 à Vienne (Autriche) et mort en 1994 à Londres. Sa réflexion sur la nature de la connaissance scientifique (versus la connaissance non-scientifique) le mène à définir une théorie comme étant scientifique seulement si elle peut être infirmée (négation). Cette vision des choses implique d’assumer une recherche qui avance sur des bases mouvantes, sujettes à une remise en question permanente.
Contenus en lien avec cet article

Pour en savoir plus sur les avancées de la recherche sur le cancer.